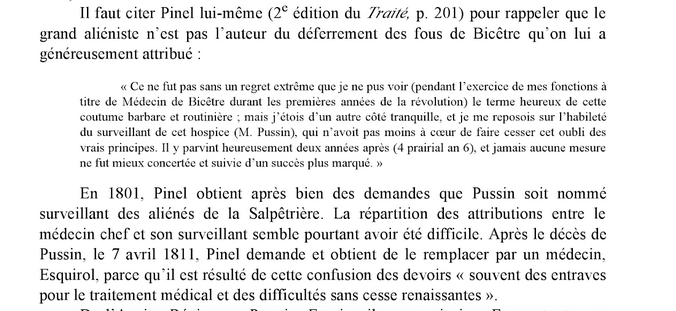Monsieur Bernard Andrieu, abuseur en récidive du copier-coller
M. Andrieu, philosophe, actuellement professeur en Staps à l'Université Paris Descartes, est l'auteur d'un chapitre intitulé
La thérapie corporelle en eau froide : Immersion-Depression-Submersion
paru dans l'ouvrage dirigé par Laurence Munoz. Usages corporels et pratiques sportives aquatiques du XVIIIe au XXe siècle, L’harmattan, Histoire du sport, 2008, pp. 255-266.
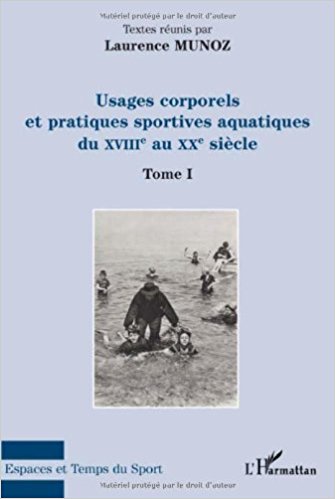 Dans ce chapitre accessible en ligne depuis juin 2010 figurent trois passages qui ont été copiés sur mon site, sans mon autorisation, sans référence ni au site ni à l'auteur et sans mention de la thèse et de la revue d'où deux d'entre eux sont extraits.
Dans ce chapitre accessible en ligne depuis juin 2010 figurent trois passages qui ont été copiés sur mon site, sans mon autorisation, sans référence ni au site ni à l'auteur et sans mention de la thèse et de la revue d'où deux d'entre eux sont extraits.
M. Andrieu a publié dans ce même chapitre des paragraphes entiers, copiés tels quels, sans mention d'origine, sur un autre site consacré à l'histoire de la psychiatrie (voir ci-dessous).
Mais il n'est pas un novice du copillage, à lire un article publié sur le site du magazine Sciences et Avenir (voir ci-après).
Peut-on être à ce point certain de son impunité pour demander ou accepter que de telles productions soient mises en ligne ? Que peuvent en penser Madame Laurence Munoz, et la présidence de son université ?
Quant aux responsables des "Archives ouvertes" (Centre pour la Communication Scientifique Directe, CNRS) que nous avons interrogé, il n'ont guère montré de scrupule à publier en ligne le texte de ce pseudo-auteur, comme on peut le lire dans l'échange ci-après :
|
Le Dim 07 Avr 2019 20:00:43, michelcaire@free.fr a écrit à Hal.support@ccsd.cnrs.fr:
Madame, Monsieur, j’attire votre attention sur une violation du droit à la copie commise par la publication d’un texte accessible sur votre site Archive ouverte. Il s’agit d'un chapitre publié dans l'ouvrage dirigé par Laurence Munoz. Usages corporels et pratiques sportives aquatiques du XVIIIe au XXe siècle [L’harmattan, Histoire du sport, 2008, pp. 255-266] signé par M. Bernard Andrieu. Je vous renvoie à la page de mon propre site internet qui expose en détail en quoi consiste l’abus caractérisé et vraiment regrettable commis par Monsieur Bernard Andrieu, qui, bien qu’il les connaisse parfaitement, contrevient à toutes les règles. Peut-être souhaiterez-vous examiner cette affaire avec Madame Laurence Munoz, qui a dirigé l’ouvrage en question, ou même avec l’intéressé. Pour ma part, je souhaite que ce document soit retiré de votre site. Vous remerciant d’avance de la suite que vous pensez pouvoir donner à cette réclamation, je vous prie d’agréer l’expression de mes salutations distinguées, Docteur Michel Caire, Psychiatre, docteur en histoire, Administrateur du site Histoire de la psychiatrie en France. La réponse d'HAL : Le 8 avr. 2019 à 13:43, Support by magron a écrit : Monsieur, Vous signalez qu'un chapitre d'ouvrage de M. Bernard Andrieu, publié dans l'ouvrage Laurence Munoz. Usages corporels et pratiques sportives aquatiques du XVIIIe au XXe siècle, L'harmattan, p. 255-266., 2008, et déposé sur HAL plagie vos travaux et vous nous demandez de retirer ce fichier de HAL. HAL est une archive ouverte dédiée à la littérature scientifique permettant de référencer les travaux publiés ou non encore publiés. Ses missions, outre la diffusion en libre accès, sont l'archivage pérenne des fichiers déposés par les chercheurs ou les bibliothécaires et de mettre en oeuvre tous moyens pour en garantir leur accès. Vous faites référence à un document qui a fait l'objet d'une publication dans un ouvrage chez un éditeur commercial, référencé dans les catalogues de bibliothèques comme dans les bases de données bibliographiques. Ce document a été déposé dans HAL par son auteur en 2010. Nous ne sommes pas en mesure d'instruire votre dossier et ne pouvons prendre de décision en la matière. Nous mettons en copie M. Andrieu (avec l'adresse mail qui est dans notre base de données). Nous regrettons de ne pouvoir donner suite à votre demande. Cordialement |
|
pages 13-15 de La thérapie corporelle en eau froide (sur les 20 pages mises en ligne sur le site HAL). Tout ce qui est en italique ci-dessous a été copié sur le site 'Histoire de la Psychiatrie en France'.
« Le règlement pour le service intérieur de l'Asile Sainte-Anne promulgué le 6 juin 1868 par Haussmann sera aussi adopté par les deux asiles "extérieurs" de la Seine, Vaucluse et Ville-Evrard. Dans l’extrait, auquel sont adjointes les additions, de celui de Saint Anne de 1868, le fonctionnement des bains et douches est codifié signifiant l’abson [sic] progressif de l’eau froide : « Les douches et les bains, sont prescrites par le médecin et exécutées par les élèves-internes, ou par lui-même. "Par suite d'une disposition très ingénieuse, l'aliéné, en s'asseyant sur ce siège mettait en mouvement une sonnerie électrique et le gardien prévenu enlevait le vase de l'extérieur. Ce système ne fonctionne plus, par suite du mauvais vouloir des gardiens à accomplir cette besogne." (F. Narjoux 1883) Les douches froides ne sont déjà plus qu'exceptionnellement utilisées comme moyen sédatif. Par contre, les bains tempérés prolongés (de une à six heures) sont administrés aux agités, dans des baignoires spéciales: un système nouveau remplace les couvercles rigides en bois ou en métal, à l'origine d'accidents: les malades sont maintenus par une toile forte (coutil) qui se fixe avec boutons et courroies sur les côtés de la baignoire. Les bains peuvent être associés à une irrigation sur la tête, qui seule émerge. Les douches en pluie sont faites par le médecin dans la piscine; une "gymnastique de chambre", scellée dans le mur d'un large couloir, "permet aux malades qui viennent d'être trempés dans la piscine, ou qui ont subi la douche froide, de faire "leur réaction". L'insuffisance du système de bains à Sainte-Anne, comme celle du système d'isolement, sera constamment dénoncée par les médecins chefs dans leurs rapports annuels: "Plus l'Administration voudra mettre à notre disposition de baignoires et de cellules, plus elle contribuera à l'amélioration, à la guérison de nos malades (...). Les bains sont notre principal moyen de traitement." (Dubuisson, 1889). En 1891, Bouchereau note que "chaque jour, on distribue 46 bains dans la forme suivante: 5 de 6 heures, 5 de 4 heures, 10 de 2 heures et 16 de 1 heure" ». [Note 31 : Organisation générale de l’Asile Saint Anne. Règlement intérieur et vie quotidienne, p. 109.] » |
À comparer avec le texte de ma thèse Contribution à l'histoire de l'hôpital Sainte-Anne (Paris): des origines au début du XX° siècle (l'illustration qui y est insérée a été également reprise par M. Andrieu) : le texte est strictement identique, à quelques fautes de frappe près [abson au lieu d'abandon et Saint Anne au lieu de Sainte-Anne par exemple].
Curieusement, une note concernant les sièges d'aisance a été insérée dans le texte concernant les douches et les bains : "Par suite d'une disposition... (F. Narjoux 1883)".
Erreur d'inattention et défaut de relecture du copieur, sans doute.
|
Sur Angers, p.12 : « Dans l’extrait du compte moral de l'année 1829 de l'hospice civil d'Angers, le traitement des alinés [sic] repose sur le bain et la douche : « Le traitement des aliénés des deux sexes admis, chaque année, à l'hospice civil, consiste, surtout dans le principe, dans des évacuations sanguines, des bains assez ordinairement chaux (sic), des douches froides ou chaudes et quelques médicamens qu'indiquent les symptomes qui compliquent souvent les différentes espèces d'aliénations mentales.
D'ailleurs, ils sont traités avec toute la douceur que leur état peut permettre, et on ne saurait trop se louer des soins empressés que leur prodiguent les Soeurs hospitalières auxquelles est confié cet emploi qui n'est pas sans danger » [note 29 : Appert, Brichet, Bourcier et Dainville, La Commission Administrative des hospices d'Angers A Monsieur Joubert Bonnaire, Maire de la Ville d'Angers, Angers, le 26 août 1831] » |
Voir sur ce même site : Les aliénés à l'hospice civil d'Angers en 1831 où cet extrait a été copié (à moins que M. Andrieu ait comme moi consulté le document aux archives où il est conservé et qu'il puisse en donner la référence)
|
Sur Broutet, p.11 : « Le comte Guillaume de Broutet (1739-1817), recteur des Pénitents Noirs de la Miséricorde d'Avignon sous l'Ancien Régime et à ce titre, administrateur de l'hospice des insensés de la ville (…)
il est rare, qu'on y fasse prendre des bains froids: une longue experience à prouvé, qu'il valoit mieux donner les bains tiedes, mais avec un robinet d'eau froide, qui coule sur la tete des insensés » (note 28 = Exposé à la convention nationale, d'une nouvelle methode, pour guerir les insensés, au moyen de remedes moraux, employés avec succès, par le citoyen Broutet, pendant son administration de l'hopital des insensés d'avignon. 1794) |
Voir sur ce même site : Michel Caire, «Le comte de Broutet, un ami de l'humanité souffrante» L'Évolution Psychiatrique, 65, 2000; 139-150
(même remarque que ci-dessus pour Angers)
Or si dans la traduction française par Doumic du Traité des maladies mentales : pathologie et thérapeutique de Griesinger, il est bien fait référence à Pinel et Brierre, c’est dans la note 1 de la p.540, ce n’est pas « Brière de Boisant » mais Brierre de Boismont, et « Pinel » n’est pas Philippe, mais son neveu Casimir.
J'ajoute que Griesinger ne met nullement en cause Pinel et Brierre qui n'ont à ma connaissance ni l'un ni l'autre employé le bain froid (et Griesinger ne dit pas le contraire), que la "paralysie" dont il parle dans la note 1 de la page suivante est la Paralysie Générale qui est la progressive Paralyse des Allemands, et que c'est chez "les malades agités, violents" que Griesinger considère que "l'eau froide ne paraît d'ailleurs que rarement indiqué" (p.541, note 1).
Passons sur « Valentin J.J. Magnan » (p.18).
Le paragraphe mérite cependant quelques mots : « En 1893 Valentin J.J. Magnan (1835-1916) invente la technique du packs en utilisant l’enveloppement froid et serré pour produite un contention, une réaction tonique au froid durant ¾ heure à une heure et refroidir le corps avant de se reprendre après l’état regressif. »
Or, s'il est bien vrai que Valentin Magnan, médecin chef du Bureau d’Admission à Sainte-Anne a pratiqué l’enveloppement humide, c'est selon la méthode inventée par Priessnitz et adaptée par divers aliénistes au traitement de la maladie mentale : il n’en a pas inventé la technique, ni d'ailleurs bien sûr le nom de ‘packs’, qui est apparu dans les années 1960 avec Woodbury. Son seul apport à notre connaissance est d'en avoir proposé une petite amélioration : l’enveloppement des pieds, qui évite leur refroidissement lors de l’emmailottement… En ce qui concerne la fin du paragraphe, assez obscur, on relèvera seulement l’anachronisme, là encore, de l’expression « état régressif ».
Quant au nom de deux des trois inspecteurs généraux, « les Docteurs Constans, Lumier et Dumesnet » (p.10), ils ont été si mal recopiés qu’ils en sont estropiés. Les corrections ont-elles été faites dans la version publiée chez L’Harmattan ?
Si les références légales de ces copiés-collés figurent dans l'ouvrage lui-même, et bien que M. Andrieu ne m'ait demandé aucune autorisation, j'effacerai tout cela de ma mémoire, et de ce site.
Je précise que je n'ai jamais refusé de donner mon accord à celui qui m'a demandé de reprendre des éléments (texte ou illustrations) publiés sur mon site. Et même si on 'oublie' de m'en demander l'autorisation, je laisse faire, à la seule condition que la provenance soit indiquée.
|
J'ajoute qu'il est assez cocasse, lorsqu'on fait une petite recherche sur Google, de voir apparaître des thèses dirigées ou présidées par Bernard Andrieu, « Professeur de Universités (Classe Exceptionnelle au 1er Sept 2017), UFR Staps, Université Paris Descartes (depuis le 1er Sept 2015) », qui portent la mention :
toute contrefaçon, plagiat, reproduction illicite encourt une poursuite pénale Dans ses fonctions de directeur de publication de la revue ‘Recherches & Educations’ [Revue généraliste de recherches en éducation et formation], membre du comité de rédaction et du comité de lecture scientifique, il est sans doute aussi attentif à détecter ces 'contrefaçons' et autres 'plagiats' ou 'reproductions illicites'. |
Michel Caire, le 2 décembre 2017
|
Un autre site victime du copillage par le même B. Andrieu
« Les asiles ne peuvent se permettre de fonctionner sans un service de bains. Il s’agit de “bains ordinaires et médicinaux, de douches ascendantes et d’étuves sèches et humides”. Mais une salle d’hydrothérapie est jugée complète lorsqu’elle comporte au moins “une piscine, une tribune, une douche mobile en lance avec jets divers, une douche verticale à clapet, en pluie et en colonne, chaude ou froide à volonté, une douche en cercle, solidement garantie par une enveloppe en bois, une douche ascendante et un bain de siège à eau courante”. Leur application, leur fréquence et leur durée sont décidées par le médecin. Parfois, il recommandait des bains quotidiens de plus de dix heures ! On distinguait trois grandes formes d’hydrothérapie : l’eau pouvait avoir une action tonique, sédative ou révulsive. Elle guérissait de tout, à condition de savamment la diriger. Ainsi, on traitait la forme congestive de la folie par des douches révulsives sur le bassin et les membres inférieurs ; la forme dépressive demandait plutôt des douches toniques et courtes ; les formes convulsive et expansive, quant à elles, étaient efficacement soignées par des bains froids, des enveloppements dans des draps mouillés, ainsi que des compresses froides sur la tête. » A comparer avec le texte publié par B. Andrieu, p.18 (le copié-collé est en italique) : « Les asiles ne peuvent se permettre de fonctionner sans un service de bains. Il s’agit de “bains ordinaires et médicinaux, de douches ascendantes et d’étuves sèches et humides”. Mais une salle d’hydrothérapie est jugée complète lorsqu’elle comporte au moins « une piscine, une tribune, une douche mobile en lance avec jets divers, une douche verticale à clapet, en pluie et en colonne, chaude ou froide à volonté, une douche en cercle, solidement garantie par une enveloppe en bois, une douche ascendante et un bain de siège à eau courante » Leur application, leur fréquence et leur durée sont décidées par le médecin. Parfois, il recommandait des bains quotidiens de plus de dix heures ! On distinguait trois grandes formes d’hydrothérapie : l’eau pouvait avoir une action tonique, sédative ou révulsive. Elle guérissait de tout, à condition de savamment la diriger. Ainsi, on traitait la forme congestive de la folie par des douches révulsives sur le bassin et les membres inférieurs ; la forme dépressive demandait plutôt des douches toniques et courtes ; les formes convulsive et expansive, quant à elles, étaient efficacement soignées par des bains froids, des enveloppements dans des draps mouillés, ainsi que des compresses froides sur la tête. » Deuxième extrait du même site : « Cependant, au XIXème siècle, on fait la subtile distinction entre l’immersion et la submersion, selon que la tête est laissée hors de l’eau ou non. L’eau doit être froide et le bain donné par surprise, car la conjonction de ce saisissement physique et psychologique posséderait des propriétés thérapeutiques. Des précautions sont prises par crainte de la noyade du malade : on restreint la durée de submersion “au temps nécessaire pour réciter le psaume du Miserere”. On nous rapporte, par exemple, le récit d’une femme atteinte de folie, chez qui les lavements rafraîchissants et les inévitables saignées n’avaient produit aucun effet. Le médecin décida alors de la faire jeter dans la rivière toute proche, à titre thérapeutique. » A comparer avec le texte publié par B. Andrieu, p.19 (le copié-collé est en italique) : « Au XIXème siècle, on fait la subtile distinction entre l’immersion et la submersion, selon que la tête est laissée hors de l’eau ou non. L’eau doit être froide et le bain donné par surprise, car la conjonction de ce saisissement physique et psychologique posséderait des propriétés thérapeutiques. Des précautions sont prises par crainte de la noyade du malade : on restreint la durée de submersion “au temps nécessaire pour réciter le psaume du Miserere”. Par exemple pour une femme atteinte de folie, chez qui les lavements rafraîchissants et les inévitables saignées n’avaient produit aucun effet, le médecin décida alors de la faire jeter dans la rivière toute proche, à titre thérapeutique. » Il est sans doute possible de trouver dans ce même texte de B. Andrieu d'autres copillages, plus brefs, tels que ces segments de phrase : « bains ordinaires et médicinaux, de douches ascendantes et d’étuves sèches et humide », qui vient de Scipion Pinel, Traité complet du régime sanitaire des aliénés, p.39 ou encore : « Les asiles ne peuvent se permettre de fonctionner sans un service de bains », que l'on retrouve dans « Flaubert et la philosophie ». Revue Flaubert, 2007, n°7 |
|
Monsieur Andrieu, récidiviste Un universitaire français abuse du copier-coller. Par Olivier Hertel le 29.10.2012 à 10h57 [site du magazine Sciences et Avenir]“PARMI LES RÉVÉLATIONS de notre enquête sur les dérives sectaires et thérapeutiques dans les hôpitaux et universités, nous avons évoqué un cas de plagiat découvert dans un livre de Bernard Andrieu, professeur à l'université de Nancy. (…) Voici deux passage du livre Toucher, se soigner par le corps, paru en 2008 aux Belles Lettres dans la collection Médecine et Sciences Humaines, dirigée par Jean Marc Mouillie maitre de conférence à la faculté de médecine d'Angers. L'auteur de ce livre Bernard Andrieu, professeur à l'université de Nancy, spécialiste de l'épistémologie du corps et des pratiques corporelles, a eu recours au copier-coller de sites internet pour rédiger les deux paragraphes que nous montrons dans ce document. Le premier extrait concerne Danis Bois et la fasciathérapie. Nous avons retrouvé ce texte dans un article publié en avril 2002 (6 ans avant la sortie du livre) sur le site d'un ostéopathe qui reprenait lui-même un texte biographique provenant du site de Danis Bois. Le deuxième extrait concerne le rebirth, une autre pratique pointée pour ses risques de dérives sectaires. Nous avons retrouvé un texte identique à ce passage dans un forum internet datant de juin 2005 (3 ans avant la sortie du livre). D'autres passages de ce livre ont été copier-coller à partir d'internet sans que les auteurs originaux aient été cités. (…)” |